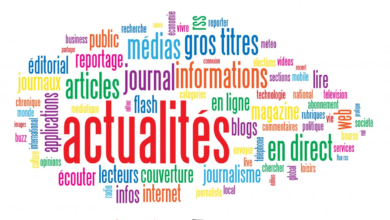L’église catholique du Burkina Faso célèbre cette année les 125 ans de sa fondation. La clôture du jubilé célébré à cette occasion aura lieu le 16 février au cours d’un pèlerinage national à Yagma. En 125 ans, quels ont été les rapports entre l’église et le pouvoir d’État ? Nous avons posé la question à un fin connaisseur de la question ; le Pr Magloire Somé, auteur d’un ouvrage sur Catholicisme, pouvoir politique et changement social au Burkina Faso de 1956 à 2000 , paru en 2022.
Vous avez beaucoup travaillé sur le rôle de l’église catholique dans l’évolution politique du Burkina Faso ; que peut-on retenir comme points essentiels de cette contribution ?
J’ai publié en octobre 2022 un ouvrage intitulé Catholicisme, pouvoir politique et changement social au Burkina Faso de 1956 à 2000 , ouvrage publié à Paris, chez Connaissances et Savoirs. Deux axes de la contribution de l’Église catholique dans l’évolution politique du pays ont été analysés. Le premier porte sur la dimension politique de sa contribution, plus exactement sur les relations entre l’Eglise catholique et l’Etat sur le terrain politique. Pour intituler cette partie, j’ai emprunté de l’historien français du fait religieux, Adrien Dansette, le concept d’« Église dans la mêlée politique ». Dans le second axe, j’analyse leurs rapports dans le domaine social en vue de la promotion humaine et j’en dégage les limites.
Dans la première partie, il s’est agi pour moi de faire un récit sur la période tardive de la décolonisation conduisant à l’indépendance politique du pays. Je pars donc de la deuxième étape de la décolonisation française qui commence avec le vote de la loi-cadre encore appelée Loi Gaston Defferre de juin 1956. C’est aussi en 1956 que le Saint-Siège nomme le premier évêque résidentiel voltaïque, Mgr Dieudonné Yougbaré. Je montre comment les forces politiques en présence, soit par le jeu de la scissiparité, soit par celui des regroupements nationaux et régionaux se sont préparées à la prise en main du destin de la Haute-Volta à partir de 1960.
À partir de la proclamation de la République autonome de Haute-Volta le 11 décembre 1958, l’épiscopat voltaïque de l’époque encore largement dominé par le clergé missionnaire esquisse, en termes de suggestions et d’orientations, des lignes du devenir du pays et de l’Afrique. Le 27 janvier 1959, il adresse aux chrétiens, et plus généralement à l’élite politique une lettre pastorale intitulé : Le chrétien dans la cité. C’est la toute première lettre pastorale adressée par les évêques aux Voltaïques de l’époque. Dans cette lettre, ils saluent la marche vers l’indépendance et expriment des souhaits pour le devenir du futur État-nation :
– Au niveau des choix politiques, ils conseillent de s’écarter du libéralisme qui renvoie au matérialisme de fait et aux inégalités criantes fragilisant le tissu social ; de rejeter le communisme qui prône l’athéisme et dont les méthodes politiques impliquent le recours à la violence et à l’embrigadement de la jeunesse. Ils se prononcent en faveur d’une laïcité qui garantisse la liberté religieuse et pour la formation d’une jeunesse responsable. Ils insistent sur la réalisation de l’unité nationale et le maintien de rapports privilégiés avec l’ancienne métropole ;
– Au niveau économique, les évêques souhaitent une réforme agraire qui implique le monde paysan dans la production pour une autosuffisance alimentaire. On peut aller vers la mécanisation, mais en recourant à des techniques adaptées à nos sols ;
– En matière d’intégration africaine, les évêques sont en faveur de la réalisation de l’unité africaine, mais conseillent aux élites de préserver la personnalité propre de la Haute-Volta.
– Ils invitent les chrétiens à s’engager dans la gestion des affaires de leur pays dans l’union avec les autres composantes de la nation.
En septembre 1962, deux ans après l’indépendance, les évêques reviennent dans une deuxième lettre pastorale (Le chrétien dans l’Eglise) donner leur compréhension de la laïcité. Ils font comprendre que la religion et le pouvoir d’État étant distincts, leurs missions sont différentes. De ce point de vue, la séparation entre des religions et de l’État s’impose. La résolution des problèmes économiques, politiques et sociaux sont du ressort de l’État. Toutefois, il revient aux évêques de rappeler la doctrine chrétienne pour éclairer les politiques dans la recherche des solutions pleinement humaines. L’idée de séparation est affirmée par la hiérarchie catholique, mais dès les premières heures de l’indépendance, des accointances entre elle et le Président de la République jettent le discrédit sur les deux autorités politique et religieuse.
Mais il ne faut pas exagérer le fait de l’accointance qui ne fit que long feu. En effet, Maurice Yaméogo se montrait capable d’un sursaut pour se mettre au-dessus de la mêlée quand la situation l’exigeait. Il montrait son désaccord avec Mgr Zoungrana, archevêque de Ouagadougou, sur un certain nombre de questions d’ordre social et sur la question de la violence politique. Il était même allé jusqu’à expulser un missionnaire, le Père Sainsaulieu qui fit à Nouna un sermon dénonçant l’embrigadement de la jeunesse par le parti-État de l’Union démocratique voltaïque.
Les accointances réapparaissent au moment de l’élévation de Mgr Paul Zoungrana à la dignité cardinalice en février 1965. L’événement eut un caractère panafricain et francophone. Toute l’Afrique francophone à l’unisson a salué l’événement. Les autorités politiques, musulmanes et chrétiennes d’Afrique francophone, s’étaient mobilisées à Ouagadougou pour cette célébration.
Le cardinal Zoungrana fut souvent le conseiller de Maurice Yaméogo lors des tensions politiques. Mais les deux hommes s’opposèrent à partir de 1963 sur la question de l’école privée catholique dont la subvention pesait sur le maigre budget de l’État. Cette subvention avait soulevé le problème de la laïcité dont l’interprétation fut étroitement interprétée par une élite musulmane organisée au sein de l’Association sociale des œuvres laïques dirigée par Triandé et qui souhaitait du reste une nationalisation de toutes les écoles. Pour elle, l’école doit être publique et laïque. Elle doit suivre un programme national. De ce point de vue, une école laïque ne saurait être tenue par une confession religieuse. Les difficultés de subvention de l’école privée catholique furent la principale pomme de discorde entre l’Église catholique et le pouvoir de la Première République. Le désaccord entre la hiérarchie catholique et l’État se poursuivit jusqu’en août 1969 où l’Église décida de remettre les écoles à l’État qui accepta de les nationaliser en septembre suivant.
Pendant l’intermède militaire de 1966 à 1978, puis pendant les crises politiques de 1978 à 1983, l’Église catholique a souvent fait des interventions critiques, se positionnant ainsi en contrepouvoir eu égard à la gestion des affaires politiques, économiques et sociales du pays, dont la gabegie le disputait à l’orthodoxie de la dépense publique. Le plus souvent, c’est par les homélies que les évêques expriment leur opinion sur la gestion de la chose publique. Les lettres pastorales interviennent assez rarement. Après 1962, il faut attendre avril 1970, avril 1978 et avril 1983 pour que les évêques expriment un jugement d’ensemble sur la gestion de la cité et de façon spécifique sur les élections de 1978. A partir de 1987, ils recourent plus fréquemment aux lettres pastorales qu’aux homélies. En effet, les homélies sont des prises de positions individuelles où les points de vue peuvent diverger entre les évêques. Par contre, par les lettres pastorales, les évêques s’accordent sur l’expression de leur opinion sur la situation nationale. La lettre pastorale a une portée plus vaste. Elle analyse la situation nationale d’ensemble et suggère des orientations aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté.
Sous le régime des prétoriens par exemple, la hiérarchie appela souvent par les homélies au retour à une vie constitutionnelle normale pour garantir les libertés. La naissance de la deuxième république fut saluée, mais l’Église dénonça avec virulence à travers une lettre pastorale (appelée lettre commune) la constitutionnalisation du rôle politique de l’armée.
Sous la IIIe République, la crise de l’État par l’agitation syndicale a amené les évêques à se montrer très préoccupés, en faisant de nombreuses interventions dans la vie politique, critiquant le manque d’idéal de la classe politique.
Sous la Révolution démocratique et populaire, le discours moralisateur des évêques provoque la furie du pouvoir prétorien. La réplique vigoureuse des autorités révolutionnaires entraîne le repli de l’épiscopat dans le silence. Mais c’est sous la Révolution qu’a couvé une révolution religieuse silencieuse. La jeunesse estudiantine s’abreuvait des idéologies politiques, mais c’est sous la Révolution que naît l’Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina (AEEMB) par sursaut d’affirmation identitaire. L’idéologie marxiste-léniniste n’a pas pu éteindre la soif de connaissance du Dieu unique. C’est sous la Révolution que les victimes de la violence révolutionnaire trouvent refuge dans le fait religieux qui apaise leurs douleurs en pansant les plaies de cette violence. Le protestantisme davantage que le catholicisme bénéficie du raz-de-marée vers la religion. Après l’implosion de la Révolution en octobre 1987, il y a une décrispation de la situation politique et une désillusion des révolutionnaires, en particulier des sankaristes qui conduisent à une sorte de révolution du croire.
Sous la IVe République, en raison de la multiplicité des crises, l’Église catholique est plus présente, soit par le jeu de la médiation, soit par le jeu de la dénonciation des dérives du pouvoir, en particulier de la corruption. C’est en ce moment que l’on note le réveil politique de l’islam, après que l’enquête démographique de 1991 ait révélé que les musulmans représentaient alors 52,6% de la population totale. Le jeu des rapports entre l’État et les confessions religieuses se complexifie dès lors. On sort de la binarité des relations entre l’État et l’Église catholique pour entrer dans une gestion de la pluralité religieuse qui repose désormais sur le jeu de l’équilibre des forces. Le pouvoir politique gère avec prudence et délicatesse la question de la diversité religieuse. Au milieu des années 1990, l’État et les organisations de la société civile notent la dégradation du climat social par la montée de l’extrémisme violent et de l’intolérance religieuse. Monsieur Naboho Kanidoua, ministre de la défense avait dû organiser en avril 1995 un atelier sur l’extrémisme violent. Mais les autorités politiques de l’époque considéraient que la question était sensible et les voies de solution extrêmement complexes et délicates.
Avec le réveil politique de l’islam se pose le débat sur la laïcité où les positions divergent dans la cité. Les musulmans sont eux-mêmes divisés dans des querelles de mosquées et de confréries qui obligent l’État à intervenir dans leurs affaires internes et qui entraînent au sein de l’islam burkinabè un phénomène fréquent de scissiparité. Au sujet de la laïcité, les uns trouvent que nous vivons dans une laïcité importée, héritage de la colonisation ; ils penchent pour notre propre laïcité, mais esquissent des idées qui relèvent elles-mêmes de l’importation d’autres modèles. La recherche de solutions endogènes n’est pas envisagée en réalité. Les autres sont dans la dynamique d’une laïcité perçue comme une séparation entre l’État les confessions religieuses, ce qui renvoie à la conception occidentale, soit de la laïcité, soit du sécularisme ou de la religion civile. Le débat sur la laïcité fait apercevoir le risque d’une fracture sociale durable de l’État. Et dans le cas du basculement vers d’autres formules, l’on court le risque de créer des citoyens de seconde zone.
Le deuxième axe de mon livre a porté sur la problématique du changement social par les transformations morales. J’y examine la nécessité pour l’Eglise de former une jeunesse chrétienne engagée et citoyenne par différents mouvements d’action catholique et bien plus, par les interventions dans le domaine de la promotion humaine aux moyens de multiples actions de développement. L’Église est devenue un partenaire important de l’État dans le domaine social. Mais ce que ce soit l’Église ou l’État, on note de sérieuses limites des deux forces dans ce domaine et une tendance aux recommencements qui font penser au mythe de Sisyphe, comme si nous étions condamnés à de sempiternels recommencements.
Beaucoup de leaders et acteurs politiques sont passés par des centres de formation liés à l’église ; cela a-t-il influencé leur action politique ?
Je répondrai à cette question par oui et non.
Oui, parce que sous la première République, l’on a vu le penchant du Président Maurice Yaméogo, ancien séminariste, pour le catholicisme. Il est allé jusqu’à demander à Jean XXIII la bénédiction pontificale pour l’accession de son pays à la souveraineté internationale. Il se montrait proche de ses amis du séminaire devenus prêtre et à qui il n’hésitait pas à faire des largesses.
Non, car du point de vue de la gestion du pouvoir d’État, ses prises de décisions ne semblaient pas refléter les valeurs cardinales enseignées par le catholicisme, en termes de prise en compte de l’intérêt général, celui de la majorité de la population, de l’équilibre entre les questions matérielles et spirituelles, etc. Sa gestion du pouvoir était contre la lettre le discours social de l’Église et les orientations conseillées par la première lettre pastorale, Le chrétien dans la cité . Ce qui veut dire que s’il y a une morale en politique, il y a aussi des impondérables dans la gestion des affaires d’État qui peut amener l’homme politique à mettre entre parenthèse certaines préoccupations relevant de l’enseignement religieux.
Non, encore une fois, parce qu’au-delà de la Première République, les élites politiques et administratives ne se laissent pas forcément influencer par les enseignements religieux. Toutes les élites qui passent par les écoles chrétiennes d’obédience catholique ou musulmane ne se montrent tenus d’une quelque influence de l’enseignement catholique. Je remarque que la plupart sont des croyants pratiquants, mais quand ils sont responsabilisés dans la gestion du pouvoir d’État, il n’apparaît pas de façon évidente une quelconque inféodation qui supposerait une dépendance du politique vis-à-vis du pouvoir religieux et vice-versa. C’est pour cette raison du reste que les évêques par leurs nombreuses homélies ont fustigé le manque d’idéal politique des élites et dénoncé la corruption qui ruine le processus d’édification de l’État-nation. Quelques citations de deux évêques montrent leur désapprobation de la manière dont les élites gèrent le pouvoir d’État. Après la chute de la première république, le cardinal Paul Zoungrana a pointé du doigt l’impréparation des élites à la gestion du pouvoir d’État :
. « Ayant transformé les consultations populaires en mystifications, la représentation nationale en formalité anodine, ayant supprimé pratiquement tout contrôle et toute critique de leur gestion, nos dirigeants n’ont pas pu faire preuve « de cette impartialité, de cette loyauté, de cette générosité, de cette incorruptibilité, sans lesquels (…) un gouvernement démocratique réussirait difficilement à obtenir le respect, la confiance et l’adhésion de la meilleure partie du peuple ! ». .
A la suite de la grève générale de décembre 1975, le cardinal Zoungrana dans son homélie du 1er janvier 1976 a dénoncé le manque de vision des élites politiques : . « dans l’ensemble, nous sommes inquiets pour l’avenir parce que nous avons le sentiment de vivre le présent sans orientation précise, sans réflexion suivie, sans engagement net ». .
Mgr Titianma Anselme Sanon, à la chute du Comité militaire de redressement pour le progrès national (CMRPN), a dénoncé de son côté la collusion du syndical et du politique, source de l’instabilité politique du pays, et fait remarquer qu’au regard de la devise nationale « Unité, travail, justice », les dirigeants en qui le peuple a placé sa confiance l’ont trompé, en raison même du fait qu’ils ont bafoué, ce symbole fort de la nation. Ils ont . « ramené le discours politique à des formules démagogiques, versé dans le pillage des biens, la corruption, les détournements, la négligence dans la gestion des biens publics » .. Pour avoir été mus par des intérêts égoïstes et manqués de conscience professionnelle, ils ont plutôt subordonné la construction nationale aux intérêts privés et particularistes, laissant la porte ouverte aux divisions de types régionaliste, ethnique et social.
On le voit bien, le fait d’être passé par les écoles chrétiennes ne fait pas ipso facto des élites engagées en politiques des dirigeants du bon aloi.
On note, en effet, que les rapports entre l’église et les hommes politiques n’ont pas toujours été paisibles et ceci dès même le premier président que fut Maurice Yaméogo ; quel commentaire en faites-vous ?
Je me suis longuement étendu dans ma réponse à votre première question sur ces tensions pouvant exister entre les dirigeants du pouvoir d’État et la hiérarchie catholique. Au-delà de la Première République, l’instabilité politique et la mauvaise gestion du pouvoir d’État ont souvent provoqué des diatribes verbales de l’épiscopat à l’endroit des hommes politiques. L’épiscopat a bien souvent voulu montrer son indépendance du pouvoir politique, prenant sa distance pour éviter des collusions compromettantes de la période de la Première république. De par cette posture, les évêques se donnaient la liberté de s’exprimer sans pointer du doigt un individu en particulier. Le discours dénonciateur et réprobateur s’adresse à la classe politique dans son ensemble. Du coup, certains dirigeants pouvaient s’irriter du ton des homélies ou mêmes des lettres pastorales, mais comme les messages n’étaient pas individualisés, il ne naissait pas de tension pouvant déboucher sur une répression de l’autorité religieuse catholique.
Le Président Sangoulé Lamizana a plus d’une fois exprimé son amertume vis-à-vis des homélies à contenus éminemment politiques du cardinal Zoungrana. Mais quand la situation l’exigeait il sollicitait celui-ci. J’ai qualifié la période des quatorze années de pouvoir du Président Lamizana, de « période de cohabitation entre le général et le cardinal ». Cela n’a pas empêché le président Lamizana de solliciter le cardinal Zoungrana dans l’organisation d’une visite officielle au Vatican au cours de l’année 1973.
En Guinée de Sékou Touré et au Bénin de Mathieu Kérékou, le pouvoir politique n’hésitait pas à réprimer des prêtres, à les jeter en prison ou à les expulser quand ils étaient missionnaires, pour l’expression de leurs opinions. Au Burkina Faso, hormis l’expulsion d’un missionnaire par Maurice Yaméogo, on n’a jamais été dans une situation de tensions. Je pourrai dire pour employer le terme de la diplomatie militaire qu’on a toujours été plutôt dans une situation de non-belligérance, c’est-à-dire que les deux pouvoirs ne cherchaient pas à s’engager dans une lutte quelconque et dans un conflit d’idées, même quand les propositions et orientations suggérées par l’épiscopat n’allaient pas dans le sens des orientations politiques des régimes politiques en place. Mais sous le CSP et la RDP, le climat qui régnait était celui de la paix armée, c’est-à-dire que l’on n’engage pas la guerre, toutefois, on pourrait l’enclencher si la limite du tolérable dans le discours épiscopal ou clérical était franchie. Le clergé pour éviter l’escalade de la violence, de sa répression par le pouvoir politique avait opté pour le silence.
On peut donc relever qu’à travers des lettres pastorales, l’église du Burkina a régulièrement donné son appréciation de la marche du pays ; ces lettres ont-elles un impact ?
Les lettres pastorales n’étaient pas adressées aux dirigeants politiques, mais aux catholiques et aux hommes de bonne volonté. Elles avaient un caractère générique. Les pouvoirs d’Etat n’étaient pas tenus de les prendre en compte dans l’élaboration de leurs projets politiques. Qu’un agent public de l’État en charge de l’élaboration d’une politique publique s’en inspire, ou en soit influencé d’une quelconque manière, c’est possible. Les idées développées par les évêques qui s’inspirent du magistère de l’Église élaboré par le Saint-Siège sont très proches de la ligne de la social-démocratie, de sorte que certains économistes du Nord ont pu qualifier le discours social de l’Église de tiers-mondisme catholique.
Pour me résumer sur ce point, je dirai que je ne vois pas d’influence directe, mais plutôt des influences indirectes.
Y a-t-il eu des moments qu’on qualifierait d’inféodation de certains acteurs politiques à l’église ou vice-versa ?
Le seul moment où l’on peut parler d’inféodation quasi réciproque, c’est pendant la période des accointances, de 1960 à 1962. Pendant ces trois années, les observations de la scène politique burkinabè relevaient des évidences de proximités gênantes. En dehors de cette période, je répondrai par non. En décembre 1965 au temps fort de la crise de contestation du régime présidentialiste de la Première République, le président Maurice Yaméogo avait demandé au cardinal Zoungrana d’user de son influence de prélat fraichement auréolé de sa dignité cardinalice pour appeler les travailleurs au calme.
Mais le cardinal Paul Zoungrana lui avait répliqué qu’il n’appartenait pas à l’évêque de s’immiscer dans les affaires politiques de l’État. Il s’en tenait ainsi à la séparation des pouvoirs. Cette prise de position du cardinal marquait une rupture d’avec le passé et un repositionnement de l’Eglise sur le plan de la neutralité vis-à-vis du pouvoir politique. L’Église catholique apparaît du reste depuis lors comme un contre-pouvoir, se donnant la liberté de parole et de critique de la gestion des affaires publiques.
Il semble que le Cardinal Zoungrana a dit que le coup d’État de Saye Zerbo est une bénédiction de Dieu ; dans quelles circonstances a-t-il pu dire cela ?
La presse et les médias rapportent qu’au moment du coup d’État du 25 octobre 1980, le cardinal Zoungrana était à l’étranger. Il avait effectué un voyage au Vatican. A son retour, à sa descente d’avion, un journaliste lui avait tendu le micro pour lui demander d’apprécier la situation politique du moment. Le prélat avait déclaré que le coup d’Etat était béni de Dieu parce qu’il n’y avait pas eu d’effusion de sang. Mais l’opinion avait tout simplement retenu que le cardinal Zoungrana avait béni le coup d’État de Saye. Comble de malheur pour le prélat, son jeune frère, Alexandre Zoungrana, fut nommé ministre de la Fonction publique ! La relation fut vite faite de la prise de position partisane du dignitaire catholique.
Après cette interview, le cardinal Zoungrana prononce le 10 décembre 1980, à l’occasion de la fête de l’indépendance, une homélie dans laquelle il confirme, me semble-t-il, une certaine jubilation dans son discours en faveur du nouveau pouvoir, mais une récrimination vis-à-vis du régime de la Troisième République qu’il avait à plusieurs reprises critiqué. Aux élections législatives de 1977 et présidentielles de 1978, il avait dénoncé les sentiments de haine et de rancœurs enfouis dans les consciences et invité à la réconciliation des fils de ce pays. Les joutes électorales s’exprimaient par des attaques personnelles des uns contre les autres, d’où se dégageait la haine, par le régionalisme dans le discours et les actes. La gestion du pouvoir de la Troisième avait exactement reflété les maux qu’il avait dénoncé. Pensait-il que le régime du CMRPN ferait mieux ?
Dans l’homélie qu’il prononce le 10 décembre 1980, à la veille de la fête de l’indépendance, il situe le coup d’État dans un contexte de tensions politiques où le risque d’affrontements conflictuels était grand. Il constate que le dénouement du conflit s’est fait sans effusion de sang. Il rend donc grâce au Seigneur d’avoir délivré la Haute-Volta de cette situation politique conflictuelle qui aurait pu plonger le pays dans le chaos. Il veut « rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits accordés à notre pays tout au long de ces vingt années écoulées et plus spécialement durant ces périodes décisives que nous venons de traverser. Face aux récents événements qui nous plongent encore dans l’émotion et la surprise et dont le dénouement aurait pu être fatal pour le pays tout entier… » . Le cardinal Zoungrana voulait livrer un message d’espérance. Le dénouement de la situation nationale sans effusion de sang lui offrait l’occasion d’exprimer « la joie qui succède à l’épreuve » . Puis il demanda la protection de Dieu pour les acteurs politiques du salut qui étaient les auteurs du coup d’Etat.
L’on a souvent pris la prise de position partisane du cardinal pour celle de toute l’Eglise voltaïque. Or, cette attitude jubilatoire du cardinal Zoungrana fut contrariée par trois évêques qui, s’exprimant à la même occasion, désapprouvèrent et condamnèrent le coup d’État du colonel Saye Zerbo. Il s’agit de Mgrs Sanon de Bobo-Dioulasso, Compaoré de Fada N’Gourma et Toé de Dédougou.
Mgr Sanon pose une série d’interrogations qui révèlent son agacement face à l’instabilité politique du pays : « Pourquoi tous ces régimes qui se succèdent et tombent chez nous comme ailleurs alors qu’ils se sont constitués et selon les lois ? Pourquoi les responsables que le Peuple lui-même a élus se trouvent-ils tout d’un coup rejetés et insultés ? Pourquoi ces joies et applaudissements quand le pays souffre ? Pourquoi ces colères et ressentiments, tant de voix dénonciatrices et haineuses alors que la vie constitutionnelle du pays est à terre et que chaque enfant de ce pays lui est nécessaire pour que nous bâtissions ensemble une nation forte ? » . Il dénonce les formules démagogiques des dirigeants politiques, le pillage des biens publics, la corruption, les détournements, l’égoïsme et le manque de conscience professionnelle, le régionalisme et l’ethnisme. Il vitupère contre les classes politiques et syndicales qui trompent le peuple.
Jean-Marie Compaoré pose lui aussi une interrogation cruciale : « La pauvreté est-elle la source de l’instabilité politique ? Il rappelle que « le pays est donné comme un champ à cultiver, un talent à fructifier, (…) un patrimoine à gérer » et dénonce, lui aussi la corruption des élites politique.
Mgr Zéphyrin Toé, évêque de Nouna-Dédougou, insiste sur l’exigence d’un examen de conscience individuel et collectif. Il rappelle que le tout n’est pas de renverser les autres et de prendre leur place si on est animé des mêmes intentions qu’eux.
Lors de l’insurrection populaire de 2014 ; beaucoup d’acteurs ont appelé à la nomination à la présidence du Faso de Mgr Paul Ouédraogo, alors président de la Conférence épiscopale ; ce qui a été refusé par l’intéressé et par l’église ; comment analysez-vous cet épisode ?
Je crois savoir que les Burkinabè étaient à la recherche d’une personne intègre et neutre. N’oubliez pas que l’idée du Burkina Faso comme « pays des hommes intègres » est davantage un projet de construction nationale qu’une réalité de fait. Les faits ont montré depuis la Révolution démocratique et populaire qu’il faut continuer de cultiver les vertus de l’intégrité pour rendre celle-ci effective.
C’est vrai, beaucoup avaient appelé à la nomination de Mgr Paul Ouédraogo, mais lui-même avait rejeté l’appel en raison de son statut d’évêque qui est inconciliable avec celui de la direction politique d’un pays, en raison du fait que l’Eglise catholique assume l’idée de séparation des pouvoirs. A la fin des années 1950 et au début des indépendances africaines, en Afrique centrale, on eut à faire à l’engagement des membres du clergé dans la vie politique de la Centrafrique et du Congo Brazzaville. Barthélémy Boganda, un prêtre ordonné en 1938 et qui exerça le sacerdoce jusqu’en 1949, s’était engagé en politique et fut le premier vice-président du conseil de gouvernement de la Centrafrique dans la mise en œuvre de la loi cadre. C’était un fédéraliste chevillé, partageant les idées senghoriennes de la fédération de l’AOF et de l’AEF qui adhèrerait au projet gaulliste de la Communauté franco-africaine. Il périt le 29 mars 1959 dans le crash de son avion qui le ramenait de Berbérati, la plus grande ville de l’Ouest centrafricain non loin de la frontière avec le Cameroun, où il était parti présenter les nouvelles institutions et le nouveau drapeau de la république centrafricaine.
Dans le Congo Brazzaville voisin, l’abbé Fulbert Youlou, un antiférédaliste et un des protagonistes sur qui pèsent les soupçons du crash de l’avion de Boganda, avait fondé un parti politique, l’Union démocratique pour la défense des intérêts africains (UDDIA). Il était reconnu pour être un habile conciliateur entre les factions politiques congolaises, ce qui a sans doute expliqué qu’il réussisse à se faire élire vice-président du conseil de gouvernement en 1959, puis président de la république congolaise qu’il dirige jusqu’à sa chute en 1963.
Ce furent là des exceptions dans la vie politique des pays africains. Il convient de dire aussi que dans ces deux pays, l’influence du catholicisme fut très grande, d’autant plus grande que devant l’impossibilité pour les élites politiques à former des coalitions pour la conquête du pouvoir d’État, le recours aux hommes du clergé catholique avait pu apparaître comme une sorte de salut. Le cas du Burkina Faso de 2014 est très différent. Le catholicisme avait drastiquement perdu de son influence dans l’échiquier national, malgré une forte audience de son épiscopat auprès de l’opinion. Il serait étonnant que le prélat catholique joue un rôle politique. Il fallait du reste l’accord du Saint-Siège, ce qui n’était pas évident.
L’église catholique du Burkina Faso se fait moins entendre aujourd’hui sur la gestion du pays ; en a-t-il toujours été ainsi sous les régimes militaires et comment expliquez-vous cela ?
Sous les régimes suivants du Général Sangoulé Lamizana, de 1966 à 1970 et de 1974 et à 1977 qui sont des régimes militaires stricto sensu de la période lamizanienne, les évêques pouvaient donner de la voie. Le Général Lamizana soignait son image de père conciliant de la nation, évitant d’apparaître comme un dictateur. Sous le CMRPN de Saye Zerbo, le défi à relever était celui du renforcement de l’administration publique par une assiduité des agents publics de l’État à leurs postes de travail, par une moralisation du travailleur dans sa relation avec son employeur qui était l’État.
Hormis les réserves des trois évêques évoquées plus haut concernant la question des coups d’État, l’épiscopat ne s’était pas préoccupé de critiquer la gestion du pouvoir. Par contre, le coup d’État du Conseil du Salut du Peuple (CSP), dirigé par le Commandant Jean-Baptiste Ouédraogo, apparaissait comme la goutte d’eau qui fit déborder le vase. Par une lettre pastorale d’avril 1983, les évêques condamnèrent la prétention des prétoriens à régenter continuellement la vie politique du pays et appelèrent à un retour à l’ordre constitutionnel, ce qui lui valut la furie du pouvoir militaire. Je crois savoir que l’épiscopat a tiré les leçons de cet intermède politique et se montre prudent quant à l’obligation de critiquer les pouvoirs qui ne sont pas issus des consultations électorales.
Interview réalisée par Cyriaque Paré
Lefaso.net
NB : Catholicisme, pouvoir politique et changement social au Burkina Faso de 1956 à 2000 est disponible à la librairie de l’universitaire Joseph Ki-Zerbo au prix de 18 000 F.